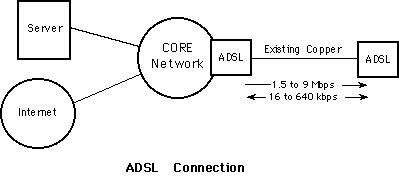
Les différences essentielles entre les nombreuses technologies DSL sont affaire de vitesse, de distance, de débit entre flux montant utilisateur/réseau public et descendant, du réseau public vers l'utilisateur.
I.2.1 HDSL / SDSL
La première technique issue de l'arbre DSL, au début des années 90, a consisté à diviser le tronc numérique du réseau, T1 aux Etats-Unis, E1 en Europe, sur plusieurs paires de fils. Et ce, grâce à la théorie du signal qui permet d'augmenter le nombre de bits par symbole transmis. On arriva à 1 168 kbits/s, tout en respectant la longueur de 5 km pour la boucle locale, sans adjonction de répéteurs. Au vu de l'amélioration sensible des performances, on baptisa cette méthode HDSL, pour High Bit Rate DSL, c'est à dire DSL à haut débits.L'extension du principe de transmission à base de codage 2B1Q ne fut pas la seule méthode employée pour faire mieux que les technologies traditionnelles AMI, utilisée pour T1, et HDB3 pour E1. Paradyne alors filiale de AT&T, développa CAP, dérivée des techniques modernes appliquées aux modems analogiques. CAP permet de coder jusqu'à 9 bits par symbole, ce qui lui valu l'agrément des sacro-saintes organisations de normalisation, en l'occurrence l'ANSI américaine et l'ETSI européenne.
Lorsque la longueur de la boucle locale l'autorise, soit environ 3 km, les systèmes HDSL à deux paires de fils peuvent être remplacés par des systèmes à une paire, ou SDSL (Single-Pair, ou Symmetric DSL).
I.2.2 ADSL
Comme son acronyme le suggère (Asymetric DSL), la technologie ADSL est basée sur un débit asymétrique. Elle assure un débit plus important dans la direction du commutateur public vers l'abonné qu'en sens inverse. En fonctions de la distance séparant l'abonné de son central téléphonique, les paires de cuivre peuvent supporter différents débits:
| Distance | Débit |
| 5,5 km (18 000 ft) | 1,544 Mbits/s (T1) |
| 4,9 km (15 000 ft) | 2,048 Mbits/s (E1) |
| 3,7 km (12 000 ft) | 6,312 Mbits/s (DS2) |
| 2,7 km (9 000 ft) | 8,448 Mbits/s |
Etant donné la complexité des modélisations des boucles locales, le plus sûr moyen de trouver les meilleures solutions est de tester en grandeur réelle les différents systèmes dans des configurations données. Ensuite, on détermine leur comportement selon divers paramètres : longueur de boucle locale, type de signaux transportés dans le même chemin de câbles, etc.
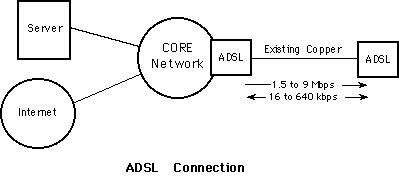
C'est en étudiant des cas de figure qu'on s'aperçut qu'il était possible de transmettre les données plus rapidement depuis le central du réseau public (commutateur) vers l'utilisateur final. Ce "phénomène" s'explique dans la mesure où la concentration de câbles est plus grande lorsqu'on se rapproche du central : il génère potentiellement plus de diaphonie à proximité du commutateur. Les signaux qui proviennent du site utilisateur étant plus atténués, ils sont plus sensibles au bruit causé par les radiations électromagnétiques.D'où l'idée d'utiliser des systèmes asymétriques, soit avec un débit plus faible vers le central, soit en se servant des techniques FDM, avec les fréquences basses pour les données vers le central et les fréquences hautes dans l'autre direction. Les systèmes utilisant ces techniques ont été baptisés ADSL : pour Asymmetric DSL.
Plusieurs types de modulation sont utilisés dans les systèmes ADSL, dont la modulation d'amplitude quadratique, ou MAQ, qu'on retrouve déjà dans les modems analogiques (notamment les modulations V34 et 56K), le CAP et le DMT.
La nécessité de définir une norme pour les applications de VDT et la démonstration par AT&T de la capacité du DMT à transférer des données vidéo encodées à 6 Mbits/s en fit un standard, tout du moins aux Etats-Unis via l'ANSI. Mais pour une fois, la normalisation était en avance : la technique VDT fut vite oubliée, à cause du succès de la TV par câble et par satellite. Aujourd'hui, CAP reste la technologie la plus déployée sur les systèmes ADSL.
I.2.3 RADSL
Avec RADSL (Rate Adaptative DSL), la vitesse de la transmission entre deux modems est fixée de manière automatique et dynamique, selon la qualité de la ligne télécoms.Aussi longtemps qu’on est resté au transfert de données vidéo, il fut hors de question de faire varier le débit. Dans ce cas, le traitement synchrone est la règle. Mais de nouvelles applications sont vite apparues pour faire oublier l'échec du VDT. Les architectures client-serveur, l’accès aux réseaux à distance et l’Internet ont ouvert de nouveaux horizons aux applications de DSL. Celles-ci ont deux avantages : la synchronisation n’y est plus nécessaire et, de même que pour les modems 56K, l’architecture asymétrique devient évidente (par exemple, beaucoup plus d’informations circulent dans le sens serveur/client que dans celui du client vers le serveur).
Ainsi on a pu définir une technologie qui adapte la vitesse de transmission aux conditions locales et l’optimisé selon des paramètres spécifiques. Les experts en télécommunications, à court d’idées ce jour-là, l’ont appelée RADSL (Rate Adaptative DSL) soit "boucle locale numérique à débit variable".
RADSL est une technique très intéressante. Elle permet de simplifier l’installation d’un nouveau service, d’autoconfigurer l’équipement de raccordement en fonction des conditions de transmission, mais aussi de donner aux fournisseurs de services l’option de configurer leurs systèmes à des vitesses fixes, pour proposer à leurs clients des coûts adaptés à leurs besoins. Le même système peut être décliné sous plusieurs formes, ce qui simplifie la gestion et la maintenance des lignes de produits. L’ANSI est en train de normaliser l’ADSL. L’organisme de normalisation considère les technologies MAQ, CAP et FDM comme modulations RADSL.
I.2.4 DSL
Tout moyen de relier la prise téléphonique à un central autocommutateur (privé ou public) peut être qualifié de DSL. Ainsi, IDSL (ISDN-DSL) désigne l’utilisation d’adaptateurs de terminaux RNIS à chaque extrémité de la boucle.
Des tests mettant en jeu de très courtes boucles locales (entre 300 et 1 500 m) ont débouché sur de nouveaux systèmes. Les technologies VDSL (Very-High Rate DSL).
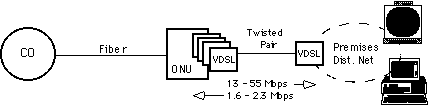
VDSL Connection
Ces technologies portent le débit maximal à 55 Mbits/s environ. Il faudra attendre au moins la fin de l’année 1998 pour leur normalisation. Ces vitesses remettent au goût du jour les applications vidéo et apportent leur lot de confusion, certains traduisant VDSL par Video DSL... Les débits VDSL sont les suivants:
| Distance | Débit |
| 1,5 km (40 500 ft) | 12,96 Mbits/s (1/4 STS-1) |
| 1 km (3 000 ft) | 25,82 Mbits/s (1/2 STS-1) |
| 300 m (1 000 ft) | 51,84 Mbits/s (STS-1) |
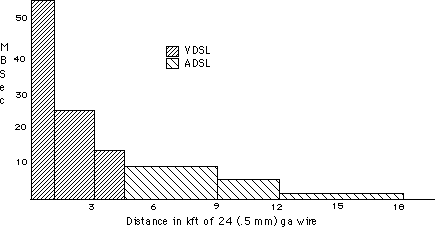
Comparatif ADSL/VDSL
Les technologies DSL sont adaptées aux accès à distance et aux transferts de fichiers, en particulier Internet, à l’interconnexion de réseaux locaux et aux accès rapprochés de type campus. En effet, elles sont indépendantes des types de réseau. Elles fonctionnent aussi bien avec les protocoles ATM que relais de trames ou IP. Quasiment toutes les architectures peuvent évoluer au moyen d’une "variation" DSL.Exemples d'architecture utilisant ADSL:

Accès à distance à un réseau
Ethernet
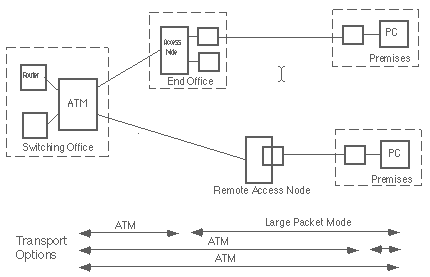
Accès à distance à un réseau ATM
La multiplication des standards peut sembler inquiétante. Surtout aux yeux de ceux qui sont à la recherche d’une solution et espèrent qu’elle ne sera pas obsolète quelque mois après ou carrément incompatible. Ce problème n’en est pas un. Le seul point important est de choisir la technique qui conviendra le mieux à la configuration physique donnée, la boucle locale étant, par définition, indépendante du reste du monde communicant. Un test dans les conditions réelles d’utilisation